
LE JOUR OU LE PETIT JORDAN DECOUVRIT LE SECOND TOUR
le RN n’a pas vraiment élargi son électorat au second tour quand les reports de votes entre ses candidats adverses se sont globalement plutôt bien passés.

le RN n’a pas vraiment élargi son électorat au second tour quand les reports de votes entre ses candidats adverses se sont globalement plutôt bien passés.

Un article de la presse économique (Capital) qui fait l’objet de
quelques observations figurant en italiques.
Avec le RN de Jordan Bardella, on va taper dans votre «épargne
dormante» !
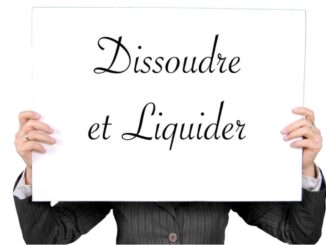
Reste à mobiliser le premier parti de
France, celui des abstentionnistes, riche de 23 992 530 membres.

Quand l’Union Indienne, dans la diversité de ses peuples, de ses
langues, de ses climats, décide d’organiser des élections législatives, cela
nécessite de prévoir un calendrier

Mais elle ne visait pas, globalement, une finalité de justice sociale etmoins encore d’efficacité économique.Depuis 1985, l’impôt sur les sociétés sera ainsi passé d’un taux […]

Depuis le 21 février et la publication du décret interministériel
d’annulation de dix milliards d’euros de crédits votés par le Parlement
moins de deux mois plus tôt, le concours Lépine des bonnes et mauvaises
fausses idées est lancé.

4 e trimestre 2023Etat 2 513,5 MdsODAC 73,7 MdsCollectivités locales 250,4 MdsSecurité Sociale 263,7 Mds2 e trimestre 2017Etat 1 790,4 MdsODAC 11,5 MdsCollectivités locales 197,5 […]

La dette publique dépasse au 31 décembre 2023
les 3 100 Mds d’euros.
Le coeur du sujet demeure donc la dette de l’État, résultat de
l’accumulation des déficits budgétaires depuis un demi siècle environ mais
surtout de choix de gestion des affaires publiques contestables.
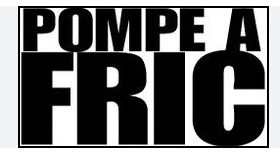
Salauds de pauvres ! Faisait dire à Grandgil, le peintre de la Traversée de Paris le romancier Marcel Aymé. Le message semble avoir été repris au […]

C’était plus ou moins annoncé et paraissait donc comme couru.Et cela n’a pas loupé, dépassant même les espérances les plus pessimistes qui pouvaient se faire […]
Copyright © 2025 | Thème WordPress par MH Themes