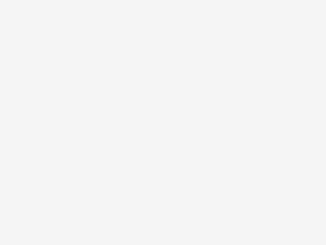
EMPLOI
Selon les données fournies par Pôle emploi lui même, le nombre de chômeurs à temps plein s’élevait au premier trimestre de l’année à 3 016 000 personnes, et les chômeurs de catégorie B et C permettaient d’ajouter 2,35 millions de personnes en plus…