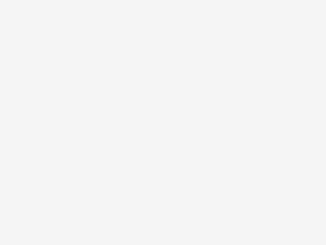
Il est temps de réinventer la politique
Dans un premier temps, quelques éléments de réponse pour que chacun-e soit informé-e comme il convient des données du problème. La CRDS, appendice de la […]
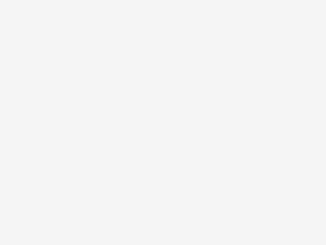
Dans un premier temps, quelques éléments de réponse pour que chacun-e soit informé-e comme il convient des données du problème. La CRDS, appendice de la […]
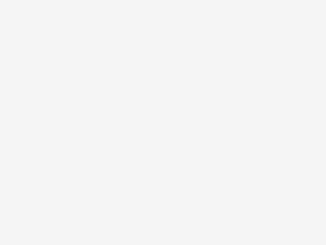
Les observations d’une association comme ACRIMED et l’avis de certain-e-s adhérent-e-s de la liste de diffusion méritent, pour le moins, que l’on produise un éclairage […]
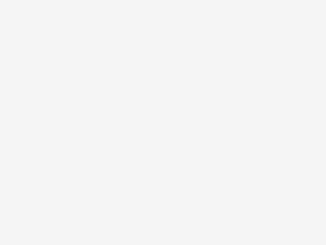
En attendant qu’un Gouvernement ne soit formé et puisse, éventuellement, commencer de travailler et proposer un certain nombre de mesures, la présente note tend à […]
Copyright © 2025 | Thème WordPress par MH Themes