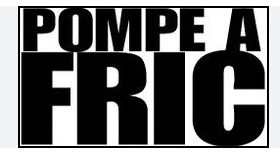
La discussion budgétaire 2026, engagée sous les auspices de la mise de côté du 49 – 3 présente assez étonnamment un exercice de pleine liberté des parlementaires, où les décisions prises en Commission peuvent être mises en cause en séance publique et où des majorités mouvantes peuvent conduire à l’adoption de mesures contradictoires.
En même temps, cet exercice de parlementarisme quelque peu baroque est la seule voie par laquelle passer pour éviter les dispositions appliquées sans discussion ni recours , marquées du sceau de l’autoritarisme le plus doctrinaire.
Car la situation du pays est loin d’être brillante, notamment quand on garde à l’esprit que l’Etat va émettre pour 310 Mds d’euros de dette publique nouvelle, dont 172 serviront d’ailleurs à amortir l’existant.
Et la purge fiscale prévue à l’origine dans le texte pour ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, le niveau des pensions et retraites ou le traitement des fonctionnaires, sinon les dotations aux collectivités locales pèse d’un poids récessif important sur des prévisions an croissance largement contrebattues par les analyses macroéconomiques et l’expérience de mesures de même nature prises dans le passé.
Deux champs principaux de l’action publique doivent être exploités pour redresser la barre.
Le premier, c’est celui de la dépense fiscale, qui a été priorisée dans les années 80 et 90 en lieu et place de la dépense publique directe, les moins values de recettes à effet retard étant préférées aux dépenses budgétaires directes sous forme de subventions.
Cela a participé par exemple de la constitution d’un parc immobilier défiscalisé, faisant monter le niveau des loyers, la rente foncière, sans pour autant résoudre les besoins collectifs en logements ; ceux ci portant de fait sur le logement de caractère social.
Le second champ de réflexion est celui de la dépense contrainte et notamment du très important volume des aides aux entreprises (entre 211 et 270 Mds d’euros selon les sources, et peut être plus selon le sort accordé à la TVA déductible) qui n’ont cessé de croître et d’embellir sans évaluation concrète et réelle de leur efficacité.
Depuis 1993 et la loi quinquennale sur l’emploi dite loi Giraud, nous sommes passés d’un à 85 Mds d’euros de cotisations sociales des entreprises prises en charge par l’Etat au travers d’une affectation de TVA, de la taxe sur les salaires et de dépenses budgétaires directes.
Y a t il moins de chômeurs et de travailleurs précaires en 2025 qu’en 1993 ?
Et les comptes de la Sécurité Sociale se portent ils mieux ?